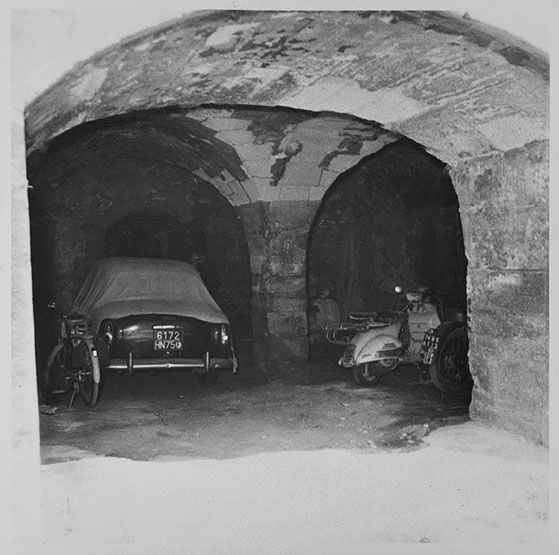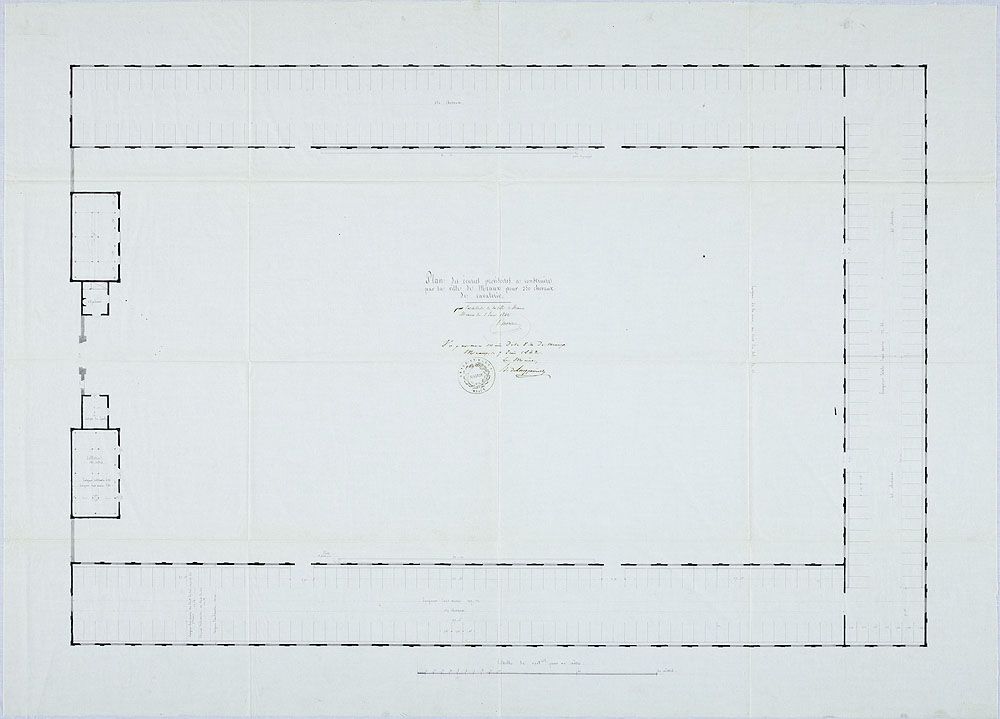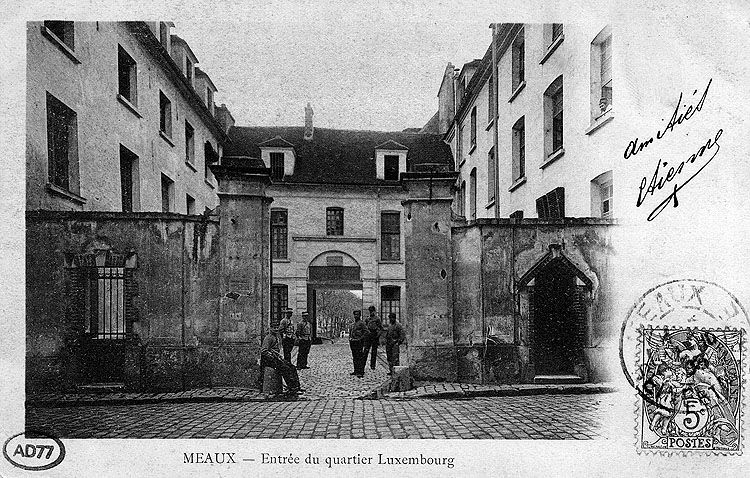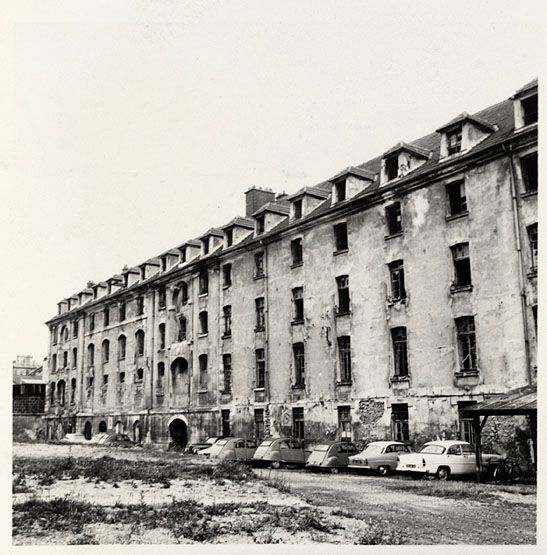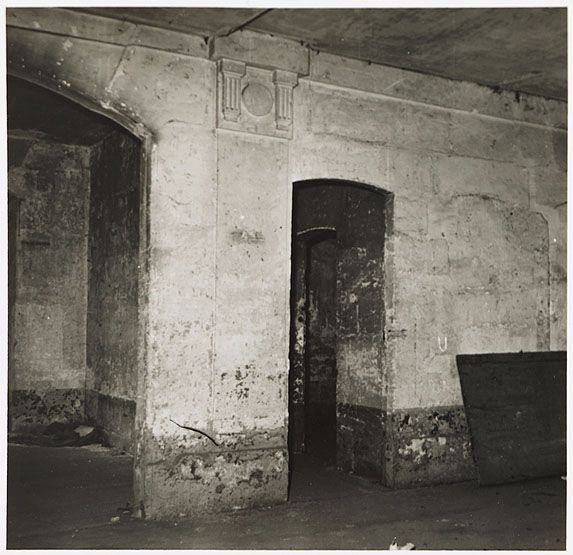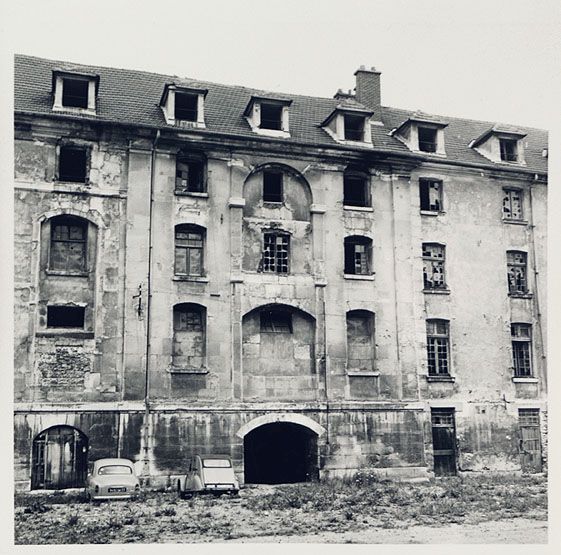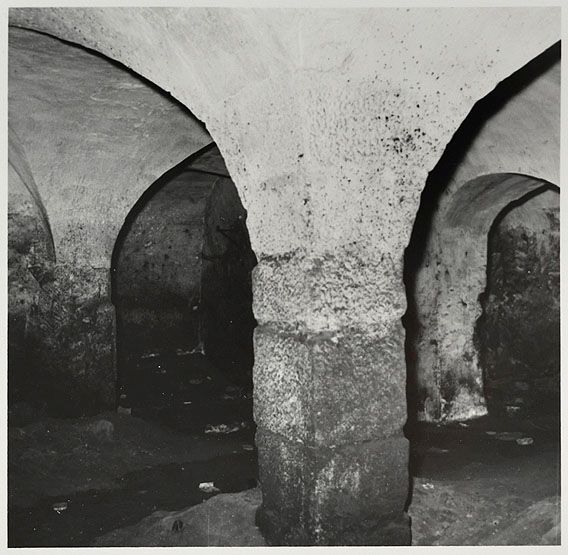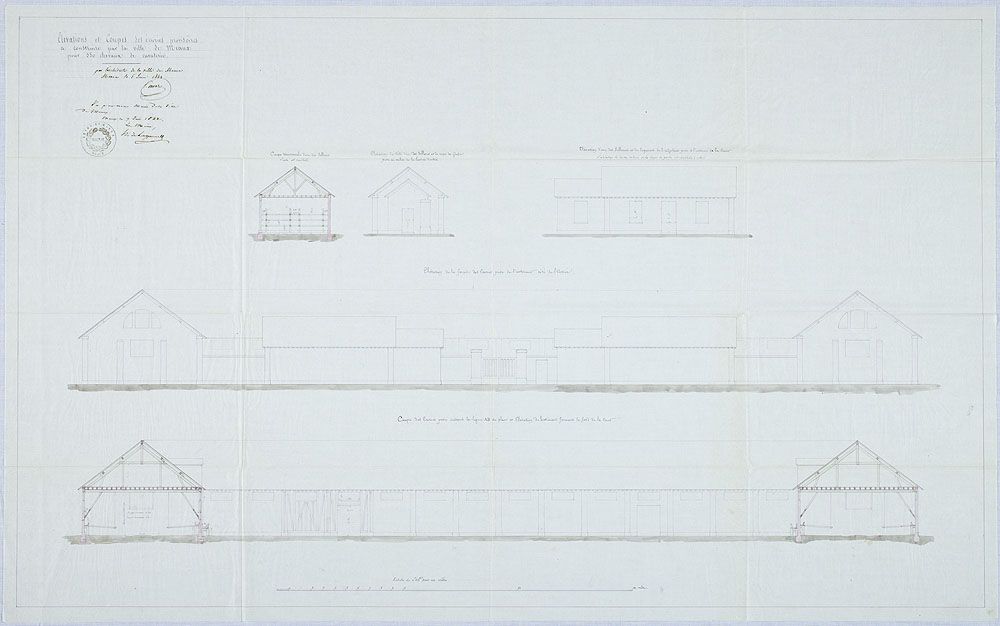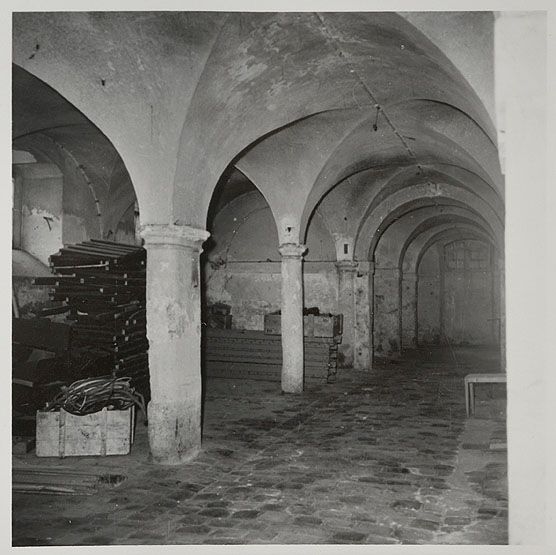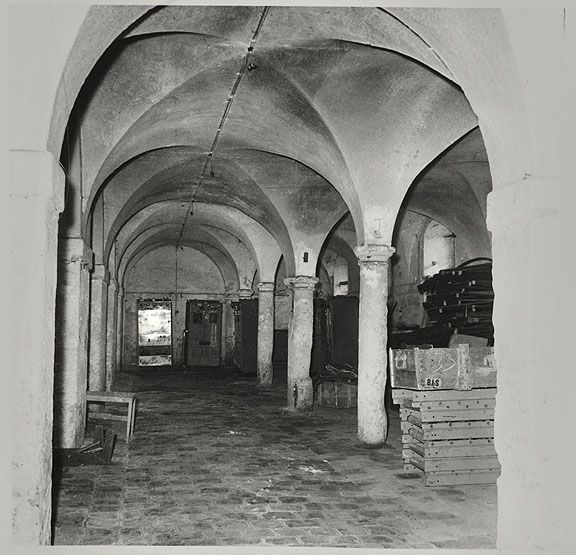Abbaye Notre-Dame, puis quartier de cavalerie Luxembourg
Désignation
Dénomination de l'édifice
Abbaye ; quartier de cavalerie
Genre du destinataire
De chanoinesses régulières de saint Augustin
Vocable - pour les édifices cultuels
Notre-Dame
Titre courant
Abbaye Notre-Dame, puis quartier de cavalerie Luxembourg
Localisation
Localisation
Île-de-France ; Seine-et-Marne (77) ; Meaux ; Cornillon (rue) 2-4
Aire d'étude pour le domaine Inventaire
Meaux
Adresse de l'édifice
Cornillon (rue) 2-4
Références cadastrales
BM 220-337
Partie constituante non étudiée
Manège ; chapelle ; salle capitulaire ; cloître ; écurie
Historique
Siècle de la campagne principale de construction
3e quart 17e siècle ; 2e quart 18e siècle ; 19e siècle
Année(s) de(s) campagne(s) de construction
1629 ; 1667 ; 1735 ; 1857 ; 1965
Commentaires concernant la datation
Daté par travaux historiques ; daté par travaux historiques ; daté par travaux historiques ; daté par travaux historiques ; daté par travaux historiques
Auteur de l'édifice
Commentaires concernant l'attribution de l'édifice
Attribution par travaux historiques ; attribution par source ; attribution par source
Personnalités liées à l'histoire de l'édifice
Vieuville, de la Marie (commanditaire)
Description historique
L'abbaye était primitivement implantée à Omont (diocèse de Reims), où elle avait été fondée en 1234. Mais les chanoinesses de saint Augustin quittèrent leur site d'origine en 1622, devant les dangers des manoeuvres militaires en cours dans la région. En avril 1629, l'abbesse Louise de la Vieuville installa sa communauté au Marché de Meaux. Marie de la Vieuville, qui lui succéda, fit bâtir la chapelle (1667-1673) et le dortoir. En 1735 fut encore construit un nouveau bâtiment, comme l'attestait une inscription transcrite par le chanoine Jouy. Les chanoinesses furent dispersées à la Révolution, mais leur chapelle fut utilisée comme église par les habitants du Marché de 1803 à 1818. Puis l'ancien monastère fut transformé en dépôt de mendicité en 1812. Il devint ensuite un quartier de cavalerie, qui connut des extensions successives tout au long du XIXe siècle, avec notamment la construction d'un manège en 1857, par Oppermann et Joret. Cet ensemble militaire fut désaffecté en 1965 et les bâtiments furent très vite rasés, malgré l'ouverture d'un dossier de protection au titre des Monuments historiques. « Cette caserne est actuellement démolie afin de permettre une vaste et indispensable opération d'urbanisme, qu'il n'était en aucun cas possible de différer », conclut le sous-préfet de Meaux en octobre 1965. Cet ensemble a fait l'objet d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC Luxembourg) dont les derniers bâtiments étaient encore en cours de construction lors de l'enquête.
Description
Matériaux du gros-œuvre
Calcaire ; enduit
Matériaux de la couverture
Tuile
Description de l'élévation intérieure
3 étages carrés ; étage de comble
Partie d'élévation extérieure
Élévation ordonnancée
Commentaire descriptif de l'édifice
La couverture photographique réalisée juste avant la destruction montre qu'il subsistait alors plusieurs bâtiments de l'abbaye Notre-Dame, à l'angle de la rue Cornillon et de la rue Jablinot. La chapelle était toujours conservée au nord, quoique son volume ait été recoupé. Une grande aile perpendiculaire à cette chapelle abritait la salle capitulaire et une galerie de cloître (murée) au rez-de-chaussée, et un dortoir à l'étage, le tout sur un niveau de caves bien appareillées avec des piliers carrés, caractéristiques du XVIIe siècle. La salle capitulaire était une vaste pièce à deux vaisseaux voûtés d'arêtes, séparés par une file de huit colonnes, et communiquant avec la galerie du cloître (elle aussi voûtée d'arêtes) par une série d'arcades cintrées reposant sur des piles rectangulaires. Outre ces bâtiments monastiques, le quartier Luxembourg comprenait divers bâtiments militaires : écuries, dortoirs, ainsi qu'un manège couvert. L'ensemble s'étendait depuis la rue Cornillon jusqu'à la Marne.
État de conservation (normalisé)
Détruit
Références documentaires
Date de l'enquête ou du dernier récolement
2011
Copyright de la notice
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de Seine-et-Marne
Date de rédaction de la notice
2014
Noms des rédacteurs de la notice et du dossier
Förstel Judith
Cadre de l'étude
Typologie du dossier
Dossier individuel